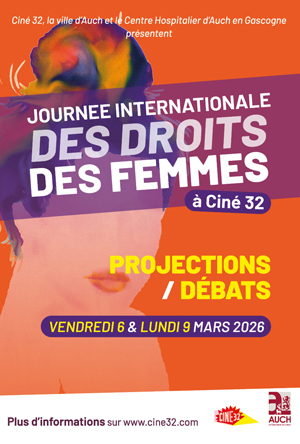Vendredi 18 avril, à la salle polyvalente, le Pays d’art et d’histoire proposait sa première conférence sur les étapes de construction de la seule cité Z.U.P. édifiée dans le département du Gers à l’heure de la politique urbaine des grands ensembles en France. Et c’est « L’origine du quartier du Garros et des immeubles collectifs (1960-1975) » qui a été retracée par Julien Defillon, doctorant à l’université Lyon II.
Devant de nombreux habitants du quartier, qui ont pu découvrir de nombreux plans et photos réalisées par des jeunes de la salle polyvalente et de la Maison des Adolescents, Julien Defillon a tout d’abord rappelé qu’ « au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, la vétusté de l’habitat en centre-ville, ajoutée à la poussée démographique, engendre alors une très forte demande de nouveaux logements. »
A partir de la fin des années 1950, Auch se lance progressivement dans des opérations de « grands ensembles » à l’architecture standardisée, avec le quartier de la Hourre et surtout avec celui du Garros à la fin de la décennie suivante. Profitant de la loi du 31 décembre 1958 instaurant le principe des Z.U.P. (Zone à Urbaniser en Priorité), les édiles municipaux décident de regrouper l’habitat sur ce secteur afin de répondre à la demande de logements, sans cesse grimpante en raison de l’exode rural et des premières migrations : « Le minimum de 500 logements fixé par la Ville va être porté à 1026 logements pour loger notamment les employés de la Seita et du Centre Hospitalier ».
Suite à l’arrêté ministériel du 19 février 1962 créant officiellement la Z.U.P. du Garros, le Conseil municipal fait appel à Paul Gardia et Maurice Zavagno, en tant qu’architectes en chef d’un projet qui prévoit deux types d’habitat : « Le collectif à l’est et le pavillonnaire à l’ouest avec au centre des équipements collectifs (école, commerces…) ».
Ces deux créateurs, considérés comme des figures de la modernité toulousaine, dressent le plan masse du futur quartier, surveillent et valident tous les projets architecturaux de la Z.U.P. confiés à des architectes d’opération locaux : Annie Sauvagé, Bernard Bouyssou, Bernard Alliot et Gil Leblanc, ce dernier réalisant les barres Porthos, Aramis, Z et le centre commercial qui se veut le lieu d’animation du quartier.
Suite à de nombreuses anicroches entre architectes qui provoquent le départ de P. Gardia et M. Zavagno, Bernard Bachelot, autre figure de l’architecture moderniste toulousaine, prend le relais en 1970 « avec une version « allégée » du quartier en optimisant les coûts et en rationalisant les surfaces ».
Cette industrialisation de la construction de 287 nouveaux logements est calquée sur « la politique des modèles » (sorte de catalogue de plans tout prêts pour les différents bâtiments) qui va être notamment utilisée pour la tour Athos, le nouveau point culminant du quartier.
En 1975-1976, l’essentiel des bâtiments de la ZUP est achevé « mais dès cette époque, on se rend compte que cette politique des grands ensembles ne fonctionne pas » conclut Julien Defillon. « Mais les constructions du Garros demeurent emblématiques de toute une page de l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme en France ».
Prochain rendez-vous, vendredi 16 mai, à 14h30 et 20h30, salle polyvalente du Garros : « Premières transformations architecturales du quartier du Garros (1981-1995) ».
Les photos